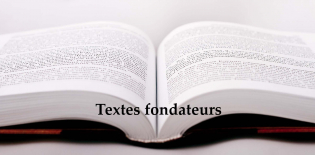Saisine de la présidente de l'assemblée de la province Sud concernant le projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 29-2014/BAPS/DIMENC du 17 février 2014 relative aux installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 50 MWth soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
La délibération modifiée n° 29-2014/BAPS/DIMEN du 17 février 2014 dite délibération « Grandes Installations de Combustion » souvent désignées par l’acronyme « GIC » s’applique, en province Sud, aux installations de combustion destinées à la production d’électricité et dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50 MWth.
Cette réglementation, inspirée des textes européens et nationaux, a été élaborée et adoptée en 2014 et poursuivait deux objectifs principaux :
1. faire progressivement converger les prescriptions applicables aux installations existantes ;
2. rapprocher les ambitions fixées par le droit local des meilleurs standards issus du droit européen en matière de protection de l’environnement.
Pour les installations en service et de conception ancienne, un délai de mise en conformité de six (6) ans avait été initialement fixé mais a été repoussé à onze (11) ans par délibération n° 341-2020/BAPS/DIMENC du 9 juin 2020. Les installations existantes à la parution de la délibération précitée ont donc jusqu’au 12 juin 2025 pour se mettre en conformité en tous points avec les dispositions de la délibération GIC modifiée.
A quelques mois à peine de cette échéance, il est désormais clair que 50% des installations de grande combustion implantées en province Sud sont dans l’incapacité de respecter l’ensemble des dispositions de la délibération « GIC » modifiée.
Le constat qui prévalait déjà en 2014 puis en 2020 concernant les difficultés de mise en conformité des installations de conception ancienne ou mise en service bien avant l’adoption de la délibération GIC modifiée est largement inchangé. Cette situation corrobore les craintes qui avaient été exprimées dès l’origine par les exploitants concernant leur capacité technico-économique à se mettre en conformité, même en prenant en compte les mécanismes d’ajustement prévus par ladite délibération. Si le dispositif en vigueur prévoit bel et bien des exemptions dans certains cas, ces dernières sont limitées et assujetties à un processus complexe et d’issue incertaine.
L’exploitant d’une installation pré-autorisée doit en effet démontrer « l'impossibilité technique et économique » de respecter intégralement les dispositions de ladite délibération dans le cadre d’un audit, soumis à la consultation du public. Au vu de ces éléments, l’exécutif provincial « peut » fixer par voie d'arrêté, toute mesure compensatoire jugée pertinente et proportionnée.
Cette incapacité de satisfaire les exigences réglementaires est principalement liée au niveau d’exigence imposé, notamment en ce qui concerne les valeurs limites d’émission (VLE) des rejets atmosphériques. Certaines valeurs limites vont en effet au-delà des exigences du droit hexagonal, comme cela était d’ailleurs mentionné dans le rapport de présentation de la délibération n° 29-2014/BAPS/DIMENC du 17 février 2014. Cette « sur-transposition » volontariste apparaît rétrospectivement fondée sur une approche trop optimiste voire utopique de la capacité technico-économique des installations de conception ancienne à se mettre en conformité sans remettre en cause la viabilité économique de leurs opérations.
La proximité de l’échéance de mise en conformité au 12 juin 2025 impose donc de reconsidérer le caractère proportionné de ce règlement, a fortiori dans le contexte d’urgence actuel qui impose aux collectivités publiques d’être particulièrement attentives à la sécurité juridique de l’environnement réglementaire.
Contrairement à 2020, l’espoir d’une mise en conformité complète des installations de production d’électricité mises en service avant l’entrée en vigueur de la délibération GIC modifiée semble désormais illusoire, pour au
moins trois (3) raisons :
● Sur le plan technique et économique, aucun progrès notable n’est intervenu concernant les méthodes de traitement des SOx, des NOx et des poussières. Le coût des techniques nécessaires au traitement de ces émissions est demeuré très élevé tant en investissement (de l’ordre de 10 milliards de francs par installation) qu’en fonctionnement (de l’ordre d’un milliard de francs CFP annuel). Aussi, les méthodes de traitement de ces polluants ne sont pas garanties, beaucoup d’incertitudes subsistent en termes de résultats. Ces coûts seraient, de plus, majorés par les conséquences économiques des nécessaires arrêts de production pendant la période de réalisation des travaux ;
● L’incertitude qui prévaut concernant les besoins énergétiques futurs en Nouvelle-Calédonie est peu propice à des investissements massifs dans des outils de production d’électricité dont l’amortissement n’est possible qu’à long terme. Si des investissements sont réalisés, il est vraisemblable qu’ils seront dédiés à des investissements dans des moyens de production renouvelables plutôt que dans des centrales anciennes, même si cela vise également à réduire leur impact sur l’environnement. Plusieurs opérateurs
de premier plan (Total et Engie) ont d’ores et déjà annoncé leur intention de stopper leurs investissements dans les moyens de production d’électricité basés sur les énergies fossiles ;
● Les projets de renouvellement du parc de centrale de production d’électricité sur le territoire par des centrales plus performantes de dernière génération ont été abandonnés. Ainsi le projet de centrale « Pays » porté par Nouvelle-Calédonie Énergie (NCE) avec le double objectif de répondre aux besoins du réseau public et de l’industrie métallurgique a été abandonné en 2022.
Faute de mise en conformité, la réglementation en vigueur pourrait ainsi conduire les exploitants à arrêter purement et simplement les installations concernées, alors que les résultats de suivi de l’association SCAL’AIR au cours des dernières années indiquent le maintien d'une bonne qualité de l’air ambiant dans leur voisinage.
La fragilisation du tissu économique en Nouvelle Calédonie en général et en province Sud en particulier oblige les pouvoirs publics à agir avec discernement de manière à ne pas aggraver une situation économique déjà critique.
Or, force est de constater que les installations concernées restent indispensables à la fourniture d’électricité aux entreprises comme aux ménages, la Nouvelle Calédonie n’ayant engagé aucune action susceptible de les remplacer à un horizon visible.
Les conséquences de l’application rétroactive des dispositions les plus extrêmes de la délibération GIC modifiée en matière d’émissions atmosphériques, notamment celles qui vont au-delà du droit hexagonal, aux installations ayant fait l’objet d’une première mise en service avant son entrée en vigueur sont manifestement disproportionnées.
Ainsi, le projet de délibération soumis à approbation propose de rectifier à la marge le dispositif en restreignant l’application de la délibération aux seules installations dont la première mise en service est intervenue postérieurement à la date de publication.
Dans une logique de sécurité juridique, il est également proposé d’une part, d’insérer la définition de la « première mise en service » comme étant la date à laquelle l’installation de combustion a produit pour la première fois de la chaleur depuis sa construction et d’autre part, de permettre au président de l’assemblée de province d’atténuer ou de renforcer les prescriptions communes de la délibération afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article 412-1 du code de l’environnement en province Sud.
La rectification limitée ainsi apportée au champ d’application de la délibération « GIC » modifiée n’empêchera nullement de continuer à réglementer les émissions atmosphériques des installations anciennes qui échapperaient désormais à son champ d’application, par le biais des autorisations d’exploitations individuelles auxquelles elles sont assujetties. Cette approche permet simplement de fixer ces prescriptions réglementaires à des niveaux adaptés à la relative ancienneté de leur conception et proportionnés aux objectifs visés.